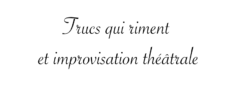La luciole passa les jours suivants les yeux clos, à baigner dans le noir d’à l’intérieur d’elle. Elle essayait d’imaginer.
D’abord, elle voulut imaginer un second soleil, qui remplacerait le premier lorsque celui-ci se couchait. Ce nouveau soleil la rassurerait durant la nuit, et même, peut-être, ce soleil aurait une bouche pour lui raconter des histoires, des yeux pour la regarder chaudement, et une pipe à mordiller en lui racontant ses histoires ? Mais cela s’avéra trop difficile : le noir d’en elle était trop épais.
Elle essaya de se représenter des ailes pareilles à celles de Lucile, qui pourrait l’emmener loin de la forêt, ou tout du moins, au-dessus de la canopée, ce nuage permanent de verdure, là où les rayons lui parviendraient mieux et plus souvent. Encore une fois, malgré tous ses efforts, le noir d’à l’intérieur d’elle resta tout noir. Peut-être les ailes de Lucile étaient trop complexes, minutieusement détaillées, pour être imaginée ? Ou trop petite ? Ou trop seule ? Ou trop loin ? Ou trop isolée ? Ou trop dépressive..?
La forêt abritait bien des phénomènes intéressants et uniques. Une fois par an, lorsque la nuit tombait, la lune et les étoiles ne se levaient pas. Le ciel, si on eût pu l’apercevoir pleinement depuis la forêt, eût été d’un noir immaculé. Ces nuits-là, aucune lumière ne parvenait jusqu’à la fleur : le noir était alors aussi noir que quand la fleur fermait ses yeux. D’ailleurs, elle ne savait plus bien si ses yeux étaient fermés ou ouverts, car avoir les paupières tombées ou levées ne faisait aucune différence : on ne voyait rien et cela était tout.
Bien sûr, la fleur était terrifiée par ces nuits, qu’elle appelait ses “ennuits“.
Lors d’une ennuit de cette sorte, un sourire lui apparut. Elle ne s’avait pas bien s’il s’agissait d’un sourire vrai, ou si son imagination avait finalement réussi à faire apparaître quelque chose. Tout ce qu’elle voyait (ou imaginait ?) c’était ce sourire plein dont les dents étaient encore plus pointues que ses propres épines.
Est-ce que tu es le fruit de mon imagination ? Demanda la fleur.
Je suis le ressac de tes peurs.
Tu as un grand sourire, dit Alizée.
Et toi, tu es une vilaine fleur.
Pourquoi est-ce que je suis vilaine ? Fit la fleur, blessée.
Toutes les fleurs sont vilaines. C’est ainsi.
Comment peux-tu savoir cela ? Est-ce que tu connais toutes les fleurs ?
J’en ai connu beaucoup, et elle étaient toutes vilaines, sèches et mortes. Est-ce que tu souhaites les voir ? Je peux te les présenter, fit le sourire en s’agrandissant.
Je veux bien ! Répondit la fleur. Peut-être qu’elles, elles m’accepteront comme je suis ? Où sont-elles ?
Chez-moi, répondit le sourire, en s’agrandissant encore.
Et où est-ce que c’est, chez toi ?
Au centre de la forêt.
Ha. je ne sais pas où cela est, et il fait trop noir, je ne saurai pas me repérer.
Je vais t’y emmener.
Et Alizée sentit qu’on la cueillait dans le noir de ses ennuits.